Alors que la crise du Covid-19 a remis en avant les graves inégalités structurelles auxquelles fait face la Seine-Saint-Denis, la seule stratégie de long terme pour le territoire semble être toujours plus de spéculation immobilière, toujours plus de relégation et toujours plus de précarisation. Il y a quelques mois, à Romainville, le promoteur Fiminco a inauguré Komunuma, son dernier projet artistique et immobilier. À partir de cet exemple, ce texte s’intéresse à la fabrique de la complicité entre art et gentrification et à la colonialité du langage qui sous-tend nombre d’initiatives culturelles publiques et privées au-delà du périphérique.
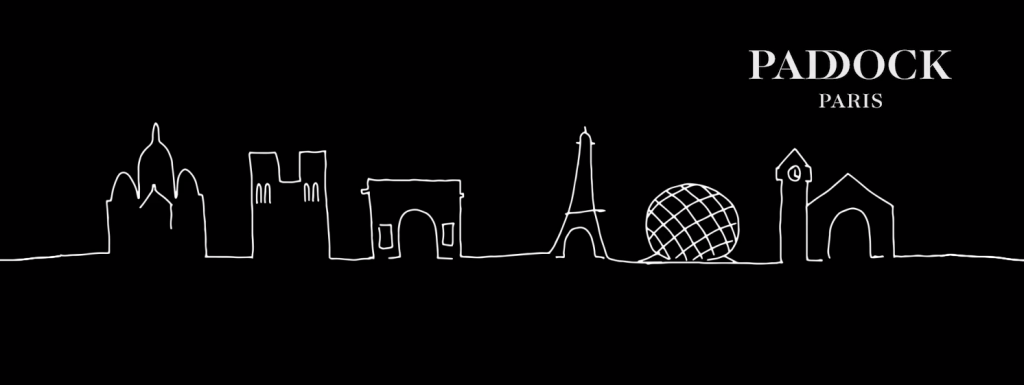
Contrairement aux idées reçues, la création contemporaine de région parisienne la plus intéressante est déjà produite et diffusée au-delà du périphérique. Mais ces initiatives n’avaient pas pour habitude d’aller de pair avec des centres commerciaux disposant d’espaces de restauration de 4 000 m² . En tout cas, pas avant l’arrivée de Komunuma, un nouveau lieu artistique ayant ouvert ses portes à Romainville à l’automne 2019. L’espace abrite quelques galeries parisiennes, l’association Jeune Création, les réserves du Frac Île-de-France, l’École d’Art et de Design Parsons Paris et la Fondation Fiminco. Cette dernière est la fondation d’entreprise du promoteur immobilier du même nom à l’origine du projet. Le site est situé juste en face du Paddock, un centre commercial appartenant lui aussi à Fiminco. Celui-ci arbore un clocher à colombages – trace architecturale des anciens usages industriels – et un écran géant qui surplombent avec étrangeté le jardin partagé adjacent du collectif Paysan Urbain. Cette installation fondée sur la spéculation immobilière, la gentrification et le déplacement des habitant·e·s ne semble être qu’un avant-goût du remodelage prévu sur le territoire de la Seine-Saint-Denis en prévision des Jeux Olympiques de 2024 à Paris.

Pourtant, l’ouverture du lieu a été accueillie chaleureusement par la presse spécialisée, sa principale préoccupation étant la viabilité des galeries se retrouvant à des kilomètres des quartiers fréquentés par leur clientèle habituelle. La résistance est, heureusement, venue d’ailleurs. En janvier 2020, le salon Jeune Création fut la première exposition à ouvrir dans l’espace de la Fondation Fiminco. À l’occasion du vernissage, plusieurs artistes participant au salon sont intervenu·e·s publiquement pour dénoncer leurs conditions de travail et d’exposition ainsi que leur instrumentalisation par le projet gentrificateur de Fiminco, avec la complicité de membres d’Art en Grève Paris-Banlieues. Les artistes ont accroché une grande bannière à l’un des balcons de l’ancien bâtiment industriel, où était inscrit : « Fiminco + Jeune Création = Précarité + Gentrification ». En février, à la suite de cette première action, deux artistes se sont retiré·e·s de l’exposition A Spoonful of Sugar, organisée par le collectif curatorial Diamètre et par Jeune Création, afin d’exprimer leur refus de participer à une logique capitaliste de privatisation des espaces publics.
Fiminco ne dissimule pas ses intentions. L’été dernier, le groupe immobilier a publié une vidéo promotionnelle intitulée Paddock Paris Gentrification qui dépeint Pantin – la ville située entre Paris et Romainville – comme le « nouveau Brooklyn ». La voix-off, aussi aguicheuse que menaçante, murmure « Les quartiers changent, leurs habitants aussi. » Des images sinistres d’un paysage urbain en train d’être démoli et remplacé par des bâtiments flambant neufs se superposent à des portraits de jeunes gens – belles, beaux et surtout blanc·he·s – et de cartes animées de Shoreditch et Kreuzberg qui illustrent les success stories de la gentrification dans le monde entier.

Romainville est en passe de souffrir non seulement de l’émergence d’initiatives privées comme Komunuma, mais également de la frénésie spéculative de l’immobilier à l’approche des Jeux olympiques de 2024, transformant déjà le territoire de la Seine-Saint-Denis. La ville de Saint-Denis connaîtra les transformations les plus importantes en accueillant des projets emblématiques comme le Village Olympique, une opération immobilière colossale de 2 200 logements – le projet est allé jusqu’à recruter un curateur star, Gaël Charbau, pour sa « direction artistique ». Romainville, comme l’ensemble de la Seine-Saint-Denis, souffre et souffrira des conséquences avec l’inflation des prix de l’immobilier. L’organisation des grands événements sportifs se fait généralement en collusion avec des promoteurs immobiliers, des organismes et des entreprises qui interviennent dans le remodelage de l’espace urbain en faveur de leurs intérêts. Ces arrangements se déploient dans le cadre de la mise en place de ces méga-événements qui entrainent des démolitions de logements, des opérations de construction massives – facilitées par les mesures extraordinaires permises par les pouvoirs publics pour tenir les délais des Jeux – et des privatisations d’espaces et d’équipements publics. Selon un rapport de l’organisation internationale Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), les Jeux olympiques ont déplacé pas moins de deux millions de personnes dans le monde entre 1998 et 2008, principalement en raison de l’inflation des prix de l’immobilier. Plus récemment, il a été estimé qu’entre 70 000 et 90 000 personnes avaient été déplacées dans le contexte des derniers Jeux Olympiques d’été à Rio de Janeiro en 2016.

La situation sanitaire actuelle – soit, au moment de l’écriture, sept semaines de confinement, d’état d’urgence avec un contrôle policier encore plus exacerbé, violent et disproportionné qu’habituellement dans les banlieues – n’a fait que mettre davantage en lumière les manques d’infrastructure affectant les quartiers populaires, notamment le manque de logements salubres et le manque d’accès aux soins. Loin de mettre fin à la gentrification rapace qui se profile, ces constats risquent d’être exploités dans la fiction de la « régénération urbaine » qui permet à ces méga-projets spéculatifs de se multiplier sans rencontrer d’opposition.

Les récits qu’alimentent les médias sont loin de freiner ces initiatives : les banlieues y sont décrites comme sombres et dangereuses, et Komunuma ou des projets similaires y incarnent les bienfaiteurs venus apporter la culture, le raffinement et un avenir resplendissant à des territoires qui en seraient privés. Dans le magazine Monocle, Hester Underhill écrit par exemple : « Loin du Marais, les galeristes s’installent dans un « quartier chaud » (edgier « hood ») ». Dans Frieze Dorian Batycka évoque « les banlieues tristement célèbres », tandis que dans Spike – avec un ton un peu moins exotisant mais pas moins condescendant – Ingrid Luquet-Gad affirme que « Komunuma offre une nouvelle occasion de trouver un équilibre entre la fétichisation du caractère brut des banlieues et son opposé, voilé mais toujours bien présent, qu’est la diabolisation et la peur de l’inconnu. »
Cette dernière citation reflète la vision étriquée que peuvent avoir beaucoup de Parisien·ne·s à propos des limites de leur ville, la démarcation du périphérique dessinant une frontière aussi bien physique que psychologique entre le centre et ses banlieues. Cette vision est entretenue par un certain monde de l’art guindé et sérieux, qui entretient un manque d’accessibilité, de diversité et d’innovation – à cet égard, l’analyse de Spike est tout à fait valide. Cependant, elle contribue à la logique selon laquelle seules la gentrification et la transformation capitaliste au-delà du périphérique peuvent résoudre l’équation en affirmant que des projets comme Komunuma mettront fin à la redéfinition perpétuelle des banlieues comme des espaces sales, inférieurs et à la marge, en décentralisant la scène parisienne collet monté. D’une part, dans le champ de l’art, c’est ignorer le travail d’espaces existants tels que La Galerie à Noisy-le-Sec, les Laboratoires d’Aubervilliers, la Ferme du Buisson à Noisiel, ou même la Maison d’art Bernard Anthonioz à Nogent-sur-Marne, pour ne citer que quelques institutions. D’autre part, le récit des banlieues comme terra nullius, une terre vide et fertile qui ne demanderait qu’à être conquise et fructifiée par le capital, sert un effacement pur et simple de l’existence des millions de personnes qui vivent et travaillent depuis longtemps au-delà des limites du périphérique, dont beaucoup d’artistes et de travailleur·se·s de l’art.
Dans le même article d’Ingrid Luquet-Gad pour Spike, les galeries commerciales s’installant à Komunuma sont décrites comme des « pionniers » car auparavant elles s’étaient installées dans des quartiers populaires de Paris qui avaient, à l’époque, une réputation analogue à celle des banlieues – notamment Belleville, Stalingrad et le 13e arrondissement. Ce langage colonial est également reproduit dans les médias français, avec par exemple la description, dans un article de Emmanuelle Lequeux, Pedro Morais et Valérie de Saint-Do publié par Le Quotidien de l’Art,du galeriste Thaddaeus Ropac – qui a ouvert un satellite à Pantin en 2012 – d’abord qualifié de « fou » mais ensuite de « pionnier ».

Plus insidieuse encore est la politique publique dite de « démocratisation culturelle » qui sous-tend ces transformations. Ce terme est présenté comme une stratégie d’extension de « la » culture aux personnes qui en seraient éloignées – les pauvres, les sans-emploi, les sans-abri, les malades, et ainsi de suite – avec pour objectif déclaré de les émanciper, même si on ne sait pas bien de quoi. En apparence, ces objectifs semblent tout à fait louables. Dans son ouvrage Artificial Hells11. Claire Bishop, Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship, Londres, Verso, 2012, 390p., Claire Bishop décrit des politiques publiques similaires adoptées au Royaume-Uni par le gouvernement New Labour dès les années 1990 comme une manière d’améliorer l’image des pouvoirs publics tout en faisant accepter l’amoindrissement des services publics par des citoyen·ne·s encouragé·e·s à considérer avant tout leur responsabilité individuelle dans leur inadéquation au monde qui les entoure. En paraphrasant Paola Merli, elle écrit « aucun des résultats [des politiques publiques] ne va changer, ni même permettre de conscientiser, les conditions structurelles qui déterminent la vie quotidienne des gens. Cela ne va que mener les gens à les accepter22. Ibid. p. 14. » La France d’Emmanuel Macron n’offre qu’un copier-coller de ces stratégies – ce qui n’est pas une surprise vu la propension de ce dernier à imiter les politicien·ne·s du tournant néolibéral anglo-saxon des années 1990.
Une manifestation matérielle de cette soi-disant politique culturelle est l’exemple du Musée numérique des Mureaux qui, d’après Le Parisien, existe car des « musées parisiens offrent leurs trésors à la banlieue ». Au delà du fait que ces musées n’offrent rien du tout – on parle d’un accès numérique à quelques tableaux et objets – c’est le ton colonial de ce langage qui frappe encore une fois, en évoquant la tristement célèbre « mission civilisatrice » qui justifiait la violence coloniale au nom de l’apport culturel. Qu’il s’agisse du contrôle policier ou de l’assimilation culturelle, la France n’a jamais cessé de traiter les populations colonisées comme telles, qu’elles soient au bout du monde ou au cœur de la métropole. Il ne s’agit pas de dénigrer le travail accompli au quotidien par les médiathèques ou bibliothèques de ces quartiers, y compris pour l’accès aux ressources numériques. Mais la politique culturelle de l’ère Macron semble se limiter à ce type d’initiatives, encouragées par un plan national qui vise à diffuser largement ces musées numériques sous l’appellation de Micro-Folies. Le projet, créature technocratique initiée par l’établissement public de La Villette – son nom est une référence à l’architecture du parc – offre une subvention de 15 000 euros aux villes qui voudraient installer un tel espace. Les Micro-Folies se présentent comme une solution clé-en-main pour collectivités désirant démocratiser la culture pour pas cher, mais elles prennent surtout le risque de renforcer les divisions sociales en perpétuant des pratiques autoritaires et verticales qui n’offrent aucune possibilité culturelle autonome digne de ce nom. Il y a cependant une certaine ironie à ce que la crise sanitaire réduise même les plus grand·e·s globe-trotteur·se·s de l’art à voir les expositions en format numérique, les mettant face à l’insuffisance flagrante de cette forme d’accès à l’art.

Le langage utilisé par les médias et les politiques publiques permet à des espaces comme Komunuma d’exister en escamotant les critiques de part et d’autre. Tout d’abord, ils peuvent se targuer d’accomplir le soi-disant acte de bienfaisance qui consiste à apporter l’art au peuple, alors qu’ils sont avant tout instrumentalisés pour opérer un art-washing de la gentrification. Quelques exemples : à Londres, l’ensemble de logements sociaux Balfron Estate, anciennement propriété de la municipalité de Tower Hamlets, a été rénové en collaboration avec le promoteur immobilier de luxe Londonewcastle. Pendant la période de transition, tandis que tous les appartements ont été vendus sur le marché privé et qu’aucun·e résident·e expulsé·e n’a pu revenir, le nouveau propriétaire offrait des baux temporaires à des artistes. À Marseille en 2017, sept initiatives culturelles se sont vues offrir des espaces sans loyer pendant trois ans rue du Chevalier-Roze par le promoteur immobilier ANF, à deux pas d’un complexe d’appartements de standing fraîchement rénovés par ce dernier rue de la République. Le projet a cependant été un échec retentissant, illustrant bien que ce n’est pas l’art seul qui gentrifie, mais les efforts du capital.

Quelques exemples émergent en région parisienne : ainsi, le collectif d’artistes Le Wonder a loué un immeuble de bureaux, voué à la démolition après qu’un groupe de personnes sans-papier en ait été chassé. Des intermédiaires fleurissent, comme l’opérateur Plateau Urbain, qui capitalise sur des « espaces transitionnels » au grand bonheur des propriétaires qui peuvent percevoir des revenus locatifs en attendant les rénovations tout en économisant sur la sécurité, les artistes qui y vivent empêchant l’établissement de squats. Enfin, ce langage politique et médiatique légitime un récit de renouvellement et de régénération des quartiers concernés à travers l’idée selon laquelle les revenus apportés par ces nouveaux commerces vont, par le biais des impôts locaux, permettre d’améliorer les infrastructures. En réalité, le temps que les améliorations des infrastructures se mettent en place, les communautés existantes auront déjà étaient déplacées et ils ne profiteront guère qu’aux nouveaux et nouvelles arrivant·e·s.
En somme, l’histoire déjà longue de l’art comme complice de la gentrification expose la vanité des fables de philanthropie et de régénération urbaine qui accompagnent ces projets.